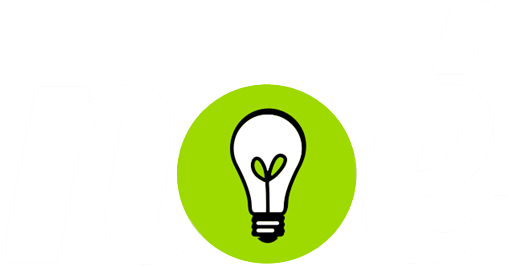C’est quoi un·e « change maker » ?
.
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » La célèbre formule de Gandhi pourrait être le motto de celles et ceux que l’on appelle les « change makers ». Mais qui sont ces individus qui entendent contribuer à changer les choses dans le « bon » sens ? Quelle est leur philosophie ? Quels sont leurs modes d’action ? La rédaction du webmagazine est partie sur leurs traces…
Change maker, entrepreneur·e social·e par définition ?
Sous le signe d’Ashoka
Le terme « change maker » est attribué à Bill Drayton, fondateur de l’ONG Ashoka créée en Inde en 1980. C’est pendant ses études à Harvard, une quinzaine d’années plus tôt, que Drayton lance les « Ashoka Table », des dîners avec des leaders politiques, économiques et religieux qui répondent à toutes les questions des étudiant·e·s sur le monde comme il va. Cette initiative porte le nom d’un mot sanscrit signifiant « absence de tristesse ». C’est aussi le nom d’un empereur de la dynastie indienne des Maurya au IIIè s. avant J.-C. On considère Ashoka comme le premier chef d’état pacifiste : il a fait prospérer son royaume en transformant la société et la culture dans le sens du respect de toutes les communautés, installé des dispositifs de solidarité entre riches et pauvres, encouragé le commerce comme alternative aux guerres.
La philosophie d’Ashoka est arrivée jusqu’à Drayton via son admiration pour Mahatma Gandhi qui comptait l’empereur de l’Inde ancienne parmi ses inspirations assumées, à côté de l’écrivain Léon Tolstoï ou de l’artiste et économiste John Ruskin. Sous autant d’influences auxquelles il faut ajouter Martin Luther King, Drayton acquiert la conviction que paix et prospérité vont de pair, qu’elles riment avec justice et solidarité, empowerment des communautés, confiance et espoir… Et que chacun·e peut agir pour transformer l’économie et la société de façon positive.
Ses études terminées, Drayton travaille quelques années pour le cabinet McKinsey puis à l’agence américaine de protection de l’environnement avant de lancer son grand projet : une ONG qui rassemblera tous les acteurs de l’innovation sociale, pour mettre en œuvre partout dans le monde des initiatives transformant les comportements, les modèles de production et de distribution, les structures des sociétés. Ashoka est née et sa médiatisation contribue à la popularisation du terme « entrepreneur social ».
L’entrepreneur social, créateur de valeur nouvelle génération
Ce mot d’ « entrepreneur social » n’est pas de Drayton : on en trouve la première occurrence en 1972 sous la plume du sociologue Joe Banks qui travaille sur les mutations de la fonction de « social worker » dans l’Amérique des Trente Glorieuses. Le « social worker » était au XVIIè siècle un être charitable, il devînt au XIXè siècle un·e militant·e, il est un fonctionnaire après la Grande dépression… Et, à l’avenir, nous dit Banks depuis ses années 1960, ce sera un entrepreneur. C’est-à-dire un créateur de valeur globale, économiquement mesurable, dont l’impact social est objectivable et qui exerce un pouvoir de transformation des usages, comportements et cultures.
Le « change making » en action
Les piliers de l’innovation sociale
Cette vision de l’entrepreneuriat social met en évidence 3 piliers du « change making » :
- Procéder de façon différente & innovante: réformer les modalités de production et de distribution, mais aussi de gouvernance et de gérance, de management, de relations parties prenantes…
- Dégager et partager la valeur créée de façon équitable: se positionner dans une perspective écosystémique, tenant compte de la condition, des intérêts, des besoins, des droits de tou·te·s celles et ceux avec lesquel·le·s on interagit. Veiller notamment à ce que chacun·e soit justement reconnu·e et rétribué·e pour sa participation à un projet.
- Enclencher des dynamiques vertueuses: être plus qu’un exemple pour d’autres, mais les entraîner dans la démarche, à la manière d’un rôle modèle, à la fois en autonomisant les populations les moins privilégiées (empowerment) et en influençant les groupes dominants pour qu’elles/ils évoluent à leur tour.
Innovation sociale = économie sociale et solidaire ?
Dans cette large acception de la fonction de « change maker », l’innovation sociale est par essence transverse : toutes les activités, tous les secteurs, tous les types de structures, tous les acteurs sont invités à la table du changement… Mais dans les faits, le « change making » s’installe bientôt en filière : l’économie sociale et solidaire.
Héritière du mouvement coopératif (proposant dès la Révolution industrielle une troisième voie entre libéralisme smithien et socialisme marxiste), cette « social economy » se définit d’abord par un système de gouvernance et d’organisation du travail alternatif à l’appareil hiérarchique reposant sur la distinction capital/travail. Concrètement, cela recouvre les organisations associatives, mutualistes, coopératives, autogestionnaires etc.
Un autre critère clé définissant la « social economy » renvoie aux objectifs de l’organisation : œuvrer à l’intérêt général, au service de toutes les parties prenantes. En pratique, cela range dans ce secteur toutes les structures qui travaillent à la réduction des inégalités, à l’accès à la santé, l’éducation et l’alimentation, à la protection de l’environnement, à la dynamisation des territoires, au commerce équitable etc.
Aujourd’hui, en tant que secteur, l’économie sociale et solidaire représente plus de 100 millions d’emplois rémunérés à travers le monde, dont 47 millions dans la zone OCDE, 15 millions sur le continent africain, 11 millions en Europe et presqu’autant en Amérique du nord, 3 millions au Brésil… Et ce n’est pas fini : l’OIT prévoit que 24 millions d’emplois sont appelés à se créer rien que dans l’économie « verte » d’ici à 2030.
Renouveler l’économie « traditionnelle »
Le dynamisme de l’économie sociale et solidaire, s’expliquant en partie par le besoin de « sens » au travail qu’expriment les nouvelles générations (et pas que…), peut donner le sentiment qu’un vaste mouvement d’innovation sociale est en marche.
Mais en regardant le « change making » comme l’affaire d’un secteur à part, on cultive un peu l’arbre qui cache la forêt : une grande majorité d’entreprises fonctionnent encore sur des schémas imprégnés de culture industrielle traditionnelle : une organisation verticale, des relations à leur écosystème entachées de rapports de force, une vision de la performance qui fait précéder le profit financier sur la valeur globale. Quoique la conscience de l’urgence de transformer ce modèle soit là, quoique la conviction soit établie que pour créer de la performance, il faut innover et que cela exige des changements culturels profonds, quoique le désir d’une « autre » entreprise et d’une « autre » vie au travail anime la plupart des acteurs du monde économique, force est de constater que le changement se confronte à de fortes résistances. C’est là que le « change maker » qui réside en chacun·e de nous a sa carte à jouer !
Tou·te·s « change makers » ?
Libérez le « change maker » en vous…
Plus qu’un secteur, le « change making » est une attitude, une posture et surtout de l’action ! Autrement dit, chacun·e de nous peut en être :
- En commençant par se changer soi-même: il s’agit de remettre en question ses convictions, ses habitudes, ses réflexes conditionnés, ses ancrages, ses pensées magiques et autres croyances ; d’interroger ses peurs et ses freins pour identifier les leviers qui les feront sauter ; de clarifier ses valeurs pour en faire le cœur de ses raisons d’agir ; de développer ses compétences relationnelles et son intelligence émotionnelle (soft skills) pour raffiner ses relations aux autres et au monde qui nous entoure ; de chausser d’autres lunettes pour regarder les choses sous des angles neufs (empathie, curiosité…) ; de se donner le courage de prendre des risques et de s’exposer (car, souvent, qui change dérange !) etc.
- En imaginant des initiatives alternatives aux modèles d’action existants: d’autres façons d’aborder les problématiques, de s’organiser, de mobiliser des ressources, de communiquer, d’échanger, de traiter avec des partenaires, d’accéder à ses « cibles » et de les engager…
Sans jamais quitter des yeux ses valeurs et objectifs, se laisser toujours la possibilité de trouver des solutions là où on ne pensait parfois pas même à aller chercher (sérendipité ! sérendipité !), traiter chaque obstacle en opportunité d’innover, oser prendre des chemins de traverse (même s’ils ne sont pas débroussaillés), partir à la conquête de nouveaux territoires…
- En apprenant de tout: à la façon des autodidactes, considérer que chaque expérience, chaque rencontre, chaque confrontation à une idée, à une pratique, à une sensation ou une émotion est une occasion de s’inspirer, de trouver des idées, de comprendre des choses, d’acquérir des compétences. Même (et surtout) ce qui parait très anecdotique voire carrément anodin ou dépourvu d’utilité immédiate est possiblement le terreau fertile d’un projet à maturer…
- En agissant avec les autres (et non pour les autres) : ne soyez plus le/la sachant·e, le/la boss, celui/celle qui est en position de donner à celles et ceux qui sont là pour recevoir ! Mais jouez la carte du fellowshipou companionship, soyez bon « camarade » dans l’aventure apprenante pour tou·te·s, à l’écoute des avis divergents au même titre que des opinions qui vont a priori dans le même sens que vous. Recherchez toujours à impliquer chaque membre du collectif et faites en sorte que chacun·e soit au contact du plus grand nombre pour que se frottent les points de vue et se conjuguent les compétences…
… Dans des conditions propices à l’exercice de la fonction de « change maker »
Beau projet que le « change making » ! Mais comment le mettre en œuvre dans des environnements contraints et processés, soumis à l’inertie des habitudes, voire franchement résistants au changement ? C’est là un gros enjeu de l’innovation sociale : elle ne peut être le fait d’individus dépourvus du pouvoir de modifier le contexte dans lequel ils évoluent et les règles du jeu qui y ont cours. Aussi, il est évident que les organisations ont leur rôle à jouer pour que des « change makers » émergent et puissent exercer pleinement leur force transformante. Ces organisations doivent :
- Donner un cadre : c’est un peu contre-intuitif quand précisément on vise à l’ « outside of the box »… Plus qu’un cadastre contractuel définissant un périmètre, le cadre est ici entendu comme une sorte de charte partenariale, indiquant des objectifs concertés (et non des process à suivre) et un code de déontologie précisant les valeurs et l’esprit dans lequel le change making s’opère (s’assurer que tous les moyens ne sont pas justifiés pour arriver aux fins, sans pour autant poser des interdits formels et des obligations trop contraignantes).
- Donner des autorisations: au-delà de la seule incantation à oser, l’organisation doit inspirer une réelle confiance à ces « change makers ». Cela passe par une culture débarrassée de ce qui nourrit l’autocensure (la peur d’être sanctionné·e d’être jugé·e etc.), inclusive pour toutes et tous et qui valorise la créativité, l’audace, la prise d’initiatives…
- Donner du temps… Et de l’espace mental à celles et ceux qui ont des projets pour changer l’ordre des choses. Certaines initiatives transformantes sont simples et rapides à opérer, d’autres demandent davantage de maturation, en passent par des ruptures de rythme (parfois, ça avance à bonne allure… A d’autres moments, c’est plus lent, voire ça reste quelques temps au point mort avant de redémarrer) ou des changements de cap. Des dispositifs comme l’intrapreneuriat, souvent mis en œuvre via la libération de 10% ou 20% du temps de travail sur une période de 6 à 18 mois sont assez efficaces pour fixer des objectifs tout en laissant place à l’inspiration, à la consultation, à la remise en question, à l’amélioration continue etc.
- Accorder le droit à l’imperfection et à l’erreur. Aucun projet innovant n’est livré du premier coup prêt à l’emploi ! Savoir accueillir un projet incomplet, nécessitant des ajustements est essentiel : d’une part pour que les « change makers » exerce leur pleine créativité et d’autre part pour qu’il y ait de l’espace d’appropriation du projet par les autres (qu’ils puissent proposer des évolutions, en faire un usage qui correspond à leurs besoins…). Il faut même aller jusqu’au droit à l’erreur : comme disait Einstein, « celui qui n’a jamais commis d’erreur n’a jamais rien essayé de nouveau». Eh oui ! L’innovation suppose que l’on se trompe, qu’on livre des choses apparemment inutiles ou étranges… Ce n’est pas du temps perdu : c’est de l’apprentissage ! Et quoi de plus enthousiasmant, finalement, que d’être toujours en train d’apprendre ?
Marie Donzel
Share this Post